Rétrospectivement je comprends bien que cette entreprise de constituer un stock de bonnes pratiques est utile, mais je crois qu'il y a plus, à savoir ne pas laisser les étudiants entre les mains d'enseignants inégalement compétents (ce n'est pas faire offense à mes collègues : comme dans tout groupe humain, il y en a de bons et de moins bons, d'attentifs et de moins attentifs). Surtout, il y a là la possibilité de transformer l'enseignement en étude, ce qui est éminemment souhaitable, comme je l'explique dans d'autres billets.
Et, d'ailleurs, je me revois, étudiant, voulant bien faire, mais placé face à une montagne de prescriptions que j'ignorais pour la plupart, et, surtout, dont j'ignorais l'existence. J'étais furieux : on me demandait de connaître des choses sans m'indiquer quoi ; on me donnait des ordres inexécutables.
Bien sûr, on aurait pu me répondre qu'il y a une sélection par l’intelligence et le travail, mais internet n'existait pas, et il aurait fallu des heures en bibliothèque pour dénicher toutes ces règles, dont, a posteriori, je ne suis d'ailleurs pas certain que mes enseignants avaient toujours une parfaite maîtrise. Aujourd'hui, je comprends que ceux qui nous invitaient à bien faire sans nous en donner la possibilité étaient des paresseux qui n'avaient pas fait le travail de constituer ce stock d’informations. D'ailleurs, je vois le même type de conduite inconvenante dans ces cours que nous ne comprenions pas, mais dont je sais maintenant que certains dispensent sans les comprendre. Accusation gratuite ? Non : comment expliquer autrement que les questions que nous posions à certains de nos enseignants n'avaient pas de réponse ? Là encore, je sais que certains collègues justifient des cours trop difficiles en disant que les étudiants devront par eux-mêmes, qu'ils seront conduits à travailler, mais alors, il faut que ces difficultés soient savamment pas orchestrées, et pas qu'elles soient des excuses . à la paresse ou à l'incompétence des enseignants.
Bref, je crois que nous avons une obligation, de constituer ces répertoires de bonnes pratiques… qui déclenchera une obligation pour les étudiants d'intégrer ces prescriptions. Ils ne pourront pas tout faire d'un coup, de sorte que nous les professeurs devront hiérarchiser, afin d'aider nos jeunes amis à monter les marches une après l'autre. Un beau travail en perspective !
Ce blog contient: - des réflexions scientifiques - des mécanismes, des phénomènes, à partir de la cuisine - des idées sur les "études" (ce qui est fautivement nommé "enseignement" - des idées "politiques" : pour une vie en collectivité plus rationnelle et plus harmonieuse ; des relents des Lumières ! Pour me joindre par email : herve.this@inrae.fr
Affichage des articles dont le libellé est bonnes pratiques. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est bonnes pratiques. Afficher tous les articles
samedi 2 septembre 2017
lundi 28 août 2017
Une bonne pratique : éviter les adjectifs et les adverbes.
Parmi les bonnes pratiques il y en a de compliquées et il y en a de simples. L'une des plus simples tient dans cette phrase : se méfier des adjectifs et des adverbes, voire les éradiquer. On se prépare à dire "de nombreuses l'étude", et l'on s'arrête : combien ? On se prépare à dire "important" : important ? On se prépare à dire "grand", "petit", etc., et cela vaut la peine de s'arrêter : grand par rapport à quoi, petit par rapport à quoi ?
La science, ce n'est pas du baratin, ce n'est pas de la "communication", au sens le plus bas. Il s'agit, pour commencer, d'avoir une caractérisation quantitative des phénomènes que l'on étudie. Ce que ne donnent pas les adjectifs, et encore moins les adverbes. "Important", c'est nul, mais "très important" !
Je propose comme une bonne pratique d'expurger de nos articles tous les mots qui ne sont que des chevilles, à commencer par les adjectifs et les adverbes. J'invite tous les auteurs de manuscrits scientifiques à éradiquer adjectifs et adverbes, tous les rapporteurs à pourchasser ces derniers.
Plus généralement, ce sont les imprécisions qui sont à bannir. Par exemple, cette expression minable "De tout temps l'homme..." : de tout temps, vraiment ? même quand l'espèce humain n'existait pas ? on voit que, là encore, on parle pour ne rien dire, puisque l'on n'apporte aucune information avec cette expression. Et puis, les généralisations sont... généralement bien dangereuses, et le grand (;-)) Michael Faraday le disait bien, parmi ses six conseils : ne pas généraliser hâtivement.
Positivement, n'oublions pas que la science commence par des caractérisations quantitatives des phénomènes qu'elle explore !
samedi 26 août 2017
Les questions à propos des expérimentations.
Cela fait bien longtemps que je m'interroge sur les règles à donner à nos étudiants à propos d'expérimentation. Par exemple, il est signalé que la blouse de laboratoire ne doit pas quitter le laboratoire et ne pas venir dans le bureau où elle contaminerait ce denier. Mais le cahier de laboratoire ? Celui là fait effectivement la navette, parce qu'il faut l'avoir sous la main pendant la manip, mais ensuite il faut exploiter les résultats, dans un bureau. Le cahier étant souillé, il contamine le bureau.
Quiconque c'est posé cette question a conclu que le cahier de laboratoire ne doit pas être sur la paillasse mais ailleurs : sur un meuble que l'on garde propre, sur une chaise… Cette fois, il y a un léger mieux… mais quand nous consignons les résultats, souvent nous avons des gants aux mains, lesquels sont souillés, et nous utilisons un stylo, qui va se contaminer par le contact avec les gants. On pourrait imaginer que le stylo reste au laboratoire mais on n'empêchera pas que le stylo contamine le cahier, qui contamine le bureau.
On sait que le risque zéro n'existe pas, et cette chaîne de petites observations à propos du cahier de laboratoire sert surtout à montrer surtout qu'il y a lieu d'être vigilant. Quel fluide tombe sur la paillasse ? Quels gestes faisons-nous ? Pourquoi les faisons nous ?
C'est par l'examen de ces mille questions que nous faisons un travail passionnant et difficile. Par exemple, faire un bon dosage, ce n'est pas seulement être patient et travailler posément ; c'est en réalité un travail qui demande de la dextérité, de l'habileté, de la patience, de la réflexion… Il faut une « intelligence expérimentale » considérable, sous peine de faire à peu près n’importe quoi… et c'est la raison pour laquelle nous devons proposer aux étudiants des séances de travaux pratiques nombreuses, et bien pensées. J'ai plaisir à signaler que l'Ecole supérieure de physique et de chimie de Paris (l'ESPCI Paris) organise ainsi les études : pendant quatre ans, des études théoriques tous les matins, et des études expérimentales tous les après midi.
Des bonnes pratiques : utiliser des méthodes officielles.
Pour exposer l'idée contenue dans le titre de ce billet, je propose de partir d'un épisode récent de notre laboratoire. Nous devions doser le dioxyde de soufre dans des vins diversement traités. Une étude bibliographique extrêmement rapide avait montré qu'une méthode, nommée méthode de Ripper, était communément employée, et il m'avait semblé, vu la simplicité du travail proposé, que ces dosages pourraient faire l'objet de stages d'étudiants. Le bilan ? Il y a eu quatre étudiants venus au laboratoire pour des périodes comprises entre un et deux mois, mais je suis désolé d'observer que le résultat total était nul.
Je ne me plains pas des étudiants, à qui je ne demande pas de produire des résultats, mais seulement d'apprendre. Or ils ont beaucoup appris, si j'en juge la liste des connaissances et des compétences qu'ils ont adjointes à leur rapport de stage, lequel a fait surtout état de travaux exploratoires. En revanche, il était intéressant d'observer que, pour des raisons que je dois encore analyser, ils s'étaient arrêtés, dans leur recherche bibliographique, à des « travaux pratiques », parfois universitaires, de qualité très variable. Or un vrai dosage, ce n'est pas une séance de travaux pratiques : les réactifs sont à préparer soi-même, dans toute leur complexité, et, surtout, les méthodes utilisées doivent être officielles et validées !
Ayant moi-même fait, après eux, une véritable recherche bibliographique, dépassant notamment les feuilles de travaux pratiques que l'on trouve dans les premières pages de Google (en français), je suis finalement arrivé, en passant par Google scholar et en cherchant en anglais, à des publications qui effectuaient ce type de dosages, et qui m'ont conduit très rapidement à des méthodes officielles. Il y en avait en français et en anglais, soit par l'AOAC (l'association américaine des chimistes analyticiens), pour les États-Unis, soit par l'OIV, l'Office international de la vigne et du vin. Dans les deux cas, les documents sont en anglais, et ils présentent des méthodes validées.
Validées : cela a imposé des études méthodologiques longues, inter-laboratoires, qui ont conduit à des protocoles finalement assez simples, et très bien documentés, qu'il s'agissait de mettre en œuvre. On observe que ces méthodes validées sont l’équivalent des méthodes de bonne pratique des société savantes médicales. Quand un médecin prescrit un médicament, il n'a pas à inventer n'importe quel traitement, mais doit se conformer à des règles professionnelles qui stipulent quel médicament doit être utilisé dans quelles conditions, et pour quelles affections. C'est à la fois une aide et un confort. Une aide, car cela signifie qu'un groupe de collègues s'est réuni pour produire un résultat synthétique, qui est validé, efficace. Un confort, parce que s'il y a le moindre accident, en raison d'un effet secondaire, d'une sensibilité particulière d'un patient, etc., alors le praticien est couvert devant la loi, ayant suivi la bonne pratique préconisée par la société savante. C'est sur elle que pèse la responsabilité de la proposition thérapeutique, parce que le praticien, suivant les bonnes pratiques, a fait du mieux que pouvait la pratique médicale, avec les connaissances du jour. On le voit, la charge est donc essentiellement sur la communauté professionnelle, laquelle doit sans cesse surveiller les progrès des connaissances pour produire les meilleures règles possibles.
Pour en revenir à notre dosage, il y avait donc des méthodes officielles, et il était hors de question de se raccrocher à n'importe quelle séance de travaux pratiques affichée par n'importe qui sur internet. Ayant finalement à faire des dosages moi-même, j'ai donc utilisé une méthode officielle, et, à l'usage, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'intelligence dans la méthode proposée. Par exemple, contrairement aux protocoles des travaux pratiques que nos étudiants avaient dégoté, il était proposé d'ajouter du chlorure de sodium à une solution d'amidon qui était utilisée pour produire un changement de couleur. Pourquoi ce chlorure de sodium ? Parce que sa présence évite la « rétrogradation de l'amylose, qui aurait prévenu la réaction avec le di-iode éventuel. Evidemment le protocole officiel proposait de chauffer l'amidon, car, ce qu’ignoraient nos jeunes amis qui n’avaient pas assez creusé leurs recherches bibliograhiques, l’amidon se trouve sous la forme de grains insolubles dans l'eau, et il faut chauffer pour que l'amylose soit libéré et qu'il puisse ensuite réagir efficacement avec le di-iode.
Et d'ailleurs, pourquoi le di-iode teinte-t-il l'amidon en bleu ou en noir ? Là, il y a évidemment lieu de s'interroger et de faire des recherches bibliographiques complémentaires, car cela semble une règle absolue de la science que de ne pas supporter de faire quelque chose qu'on ne comprend pas. J'aurais mauvais grâce à critiquer les étudiants qui sont venus en stage dans notre laboratoire de ne pas avoir fait cette recherche, car je me souviens avoir été membre d'un jury de recrutement de maître de conférence en chimie des sucres dans une grande université parisienne, et, ayant posé cette question du changement de couleur de l'amidon avec le di-iode, je n'avais reçu aucune réponse d'aucun des candidats (à vrai dire, ce n'est pas exact : il y a eu un candidat qui a répondu n'importe quoi avec aplomb, espérant me bluffer, alors que j'ai la réponse depuis longtemps ; inutile de dire que j'ai renvoyé publiquement ce malhonnête dans ses seize mètres).
A propos de la solution de di-iode, il y avait cet autre petit mystère, que l'on dissout le di-iode dans une solution d'iodure de potassium. Le niveau zéro de l'étudiant, c'est de ne pas chercher à savoir pourquoi on utilise cet iodure de potassium et de ne pas l'utiliser. Le niveau supérieur, c'est de ne pas poser la question, mais d'utiliser l'iodure de potassium prescrit. Mais on peut viser mieux, et se poser la question. Ou, encore mieux : se poser la question, réfléchir et calculer, avant de confronter son résultat à une étude bibliographique. On trouve finalement que le di-iode n'est pas soluble dans l'eau, et c'est par la formation d'un fait de trois atomes d'iode qu'il peut se solubiliser, ce qui impose la présence d'ions iodure. Quel bonheur que de découvrir toutes ces particularités des transformations moléculaires !
Et puis, il y a une foule de détails, telle la concentration particulière de di-iode qu'il faut utiliser. Pourquoi cette concentration particulière ? A l'usage, il est apparu qu’une solution dix fois plus diluée montrait moins les changements de couleur que l'on visait, alors qu'une solution plus concentrée faisait perdre en sensibilité. J'en passe, parce qu'i y aune foule de détails expérimentaux, qui avaient fait en réalité l'objet de discussions préalables, par les sociétés savants, qui avaient abouti à un protocole validé. Il y a donc lieu de commencer par des protocoles validés avant de tester tout et n'importe quoi pour n'arriver à rien.
mardi 8 août 2017
Bonnes pratique : être à la hauteur de ses dires
Au terme de cette série de billets inspirés par le Responsible Science de l'Académie américaine des sciences, je m'aperçois que je n'aimerais pas être du groupe qui a produit ce document : à ne voir que le crime, que la fange, la boue, on ne peut manquer de la voir partout.
Tiens, aujourd'hui, je trouve dans ce document :
Misrepresenting speculations as fact or releasing preliminary research results, especially in the public media, without providing sufficient data to allow peers to judge the validity of the results or to reproduce the experiments
Ce qui signifie en français : "Faire croire que des spéculations sont avérées, ou publier des résultats de recherche préliminaires, notamment dans les média à l'attention du public général, sans fournir assez de données aux pair pour que ceux-ci puissent juger de la validité des résultats ou reproduire les expériences". Cela dit, il est vrai que le désir d'être encensé conduit certains à des comportements étranges, et je ne peux manquer de me souvenir de notre deuxième colloques international de gastronomie moléculaire, où plusieurs des participants initiaux étaient devenus des vedettes... dont le comportement avait changé ; la présence de journalistes dans nos débats les conduisait à se comporter en vedettes, au lieu d'être en position de discuter de questions scientifiques. Ah, ce fatal ego ! Il fallut interdire la participation de la presse à partir des troisièmes rencontres.
Mais levons le nez de la boue, et regardons le ciel, car il est bleu ! Oublions la publication pour le bonheur de la production scientifique, et, soudain, tout change : comment, alors, irions-nous trop vite à confondre des spéculations et des faits ? Nous savons bien que le diable est caché dans le moindre détail expérimental, dans le moindre calcul, et nous n'avons en réalité pas besoin des pairs pour évaluer nos travaux, puisque nous en sommes les premiers censeurs, les premiers rapporteurs. L'explorateur, dans la jungle, n'a pas besoin de public, pour savoir s'il avance ou non, et il sait que c'est à la sueur de la machette qu'il peut se frayer un chemin ; il sait combien de route il parcourt, et il sait que son cheminement est lent.
Oui, décidément, la vertu est sa propre récompense, et nos avancées scientifiques sont ce qu'elles sont : du pur bonheur quand nous faisons le travail soigneusement !
Tiens, aujourd'hui, je trouve dans ce document :
Misrepresenting speculations as fact or releasing preliminary research results, especially in the public media, without providing sufficient data to allow peers to judge the validity of the results or to reproduce the experiments
Ce qui signifie en français : "Faire croire que des spéculations sont avérées, ou publier des résultats de recherche préliminaires, notamment dans les média à l'attention du public général, sans fournir assez de données aux pair pour que ceux-ci puissent juger de la validité des résultats ou reproduire les expériences". Cela dit, il est vrai que le désir d'être encensé conduit certains à des comportements étranges, et je ne peux manquer de me souvenir de notre deuxième colloques international de gastronomie moléculaire, où plusieurs des participants initiaux étaient devenus des vedettes... dont le comportement avait changé ; la présence de journalistes dans nos débats les conduisait à se comporter en vedettes, au lieu d'être en position de discuter de questions scientifiques. Ah, ce fatal ego ! Il fallut interdire la participation de la presse à partir des troisièmes rencontres.
Mais levons le nez de la boue, et regardons le ciel, car il est bleu ! Oublions la publication pour le bonheur de la production scientifique, et, soudain, tout change : comment, alors, irions-nous trop vite à confondre des spéculations et des faits ? Nous savons bien que le diable est caché dans le moindre détail expérimental, dans le moindre calcul, et nous n'avons en réalité pas besoin des pairs pour évaluer nos travaux, puisque nous en sommes les premiers censeurs, les premiers rapporteurs. L'explorateur, dans la jungle, n'a pas besoin de public, pour savoir s'il avance ou non, et il sait que c'est à la sueur de la machette qu'il peut se frayer un chemin ; il sait combien de route il parcourt, et il sait que son cheminement est lent.
Oui, décidément, la vertu est sa propre récompense, et nos avancées scientifiques sont ce qu'elles sont : du pur bonheur quand nous faisons le travail soigneusement !
lundi 7 août 2017
Bonnes pratiques : jusque dans les relations humaines
Etonnant document que ce Responsible Science de l'Académie américaine des sciences : il nous fait part d'environ toutes les infamies possibles, dans le milieu scientifique.
Par exemple, j'y trouve :
Inadequately supervising research subordinates or exploiting them
Oui, il est vrai que mal diriger des collègues est répréhensible. Les exploiter aussi. Mais plus positivement, ne pourrions-nous pas nous poser la question suivante : comment bien diriger des recherches ?
La question est bien difficile, car il y a ce "diriger", qui est terrible. Peut-on vraiment "diriger" un scientifique digne de ce nom ? A la seule évocation de la "direction", je ne peux m'empêcher de penser à Frères Jean des Entommeures qui répondait à l'offre de diriger une abbaye "Comment dirigerais-je autrui, alors que je ne me gouverne pas moi-même ?".
Diriger ? Cela signifie, étymologiquement, donner une direction. Mais reprenons la question : il s'agit de science, donc de faire des découvertes. Comment être certain que nous mettrons nos amis sur la piste de découvertes, alors que nous ne sommes pas nous-mêmes certain de savoir dans quelle direction nous-même devons chercher ? Il y aurait ainsi de l'inconscience à diriger les autres ! Et une telle responsabilité ! Imaginons que nous les mettions sur une mauvaise piste !
Bien sûr, on peut aussi prétendre que peu importe la direction, le chemin que l'on fait emprunter ou que l'on emprunte soi-même, et que tout est dans la "composition" (au sens de la composition florale, de la composition de parfums, de la composition musicale, de la composition de tableaux, de la composition littéraire...) que nous faisons, à partir d'observations quantitatives du monde. Oui, on peut prétendre que même pour les sciences de la nature, "la beauté est dans l'oeil qui regarde" : on ne découvre que ce que l'on décide de voir, telle la découverte des fullérènes dans cette suie qui est sous les yeux de l'humanité depuis la découverte du feu.
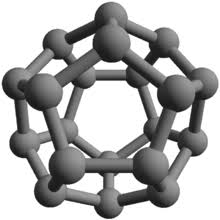
Mais quand même, n'y a-t-il pas des directions plus fructueuses que d'autres ?
Je ne sais pas, puisque, portant cette question conférence après conférence, dans le monde entier, je n'ai guère reçu de commentaires sur la question de la stratégie scientifique, qui est en réalité celle qui est discutée ici.
Mais revenons à la "direction de recherches". Je me demande quand même si ce que nous nommons "directeur de recherche", en France, n'est pas seulement la direction administrative de la recherche. C'est à dire un travail tout à fait sans intérêt du point de vue scientifique ! La vraie question n'est-elle pas la question de la recherche elle-même ?
Pour ce qui me concerne, quand j'agis en "directeur de thèse", par exemple, j'essaie surtout d'être un "rapporteur bienveillant", qui apporte de la culture scientifique, de cette culture qui permet de mieux voir les faits expérimentaux, de mieux les interpréter. Je suis là pour signaler des bonnes pratiques, les expliquer, et, surtout, pour être "contagieux d'enthousiasme" pour cette merveilleuse recherche scientifique.
Car nous avons besoin d'être entourés, aimés, encouragés, et non pas dirigés !
Par exemple, j'y trouve :
Inadequately supervising research subordinates or exploiting them
Oui, il est vrai que mal diriger des collègues est répréhensible. Les exploiter aussi. Mais plus positivement, ne pourrions-nous pas nous poser la question suivante : comment bien diriger des recherches ?
La question est bien difficile, car il y a ce "diriger", qui est terrible. Peut-on vraiment "diriger" un scientifique digne de ce nom ? A la seule évocation de la "direction", je ne peux m'empêcher de penser à Frères Jean des Entommeures qui répondait à l'offre de diriger une abbaye "Comment dirigerais-je autrui, alors que je ne me gouverne pas moi-même ?".
Diriger ? Cela signifie, étymologiquement, donner une direction. Mais reprenons la question : il s'agit de science, donc de faire des découvertes. Comment être certain que nous mettrons nos amis sur la piste de découvertes, alors que nous ne sommes pas nous-mêmes certain de savoir dans quelle direction nous-même devons chercher ? Il y aurait ainsi de l'inconscience à diriger les autres ! Et une telle responsabilité ! Imaginons que nous les mettions sur une mauvaise piste !
Bien sûr, on peut aussi prétendre que peu importe la direction, le chemin que l'on fait emprunter ou que l'on emprunte soi-même, et que tout est dans la "composition" (au sens de la composition florale, de la composition de parfums, de la composition musicale, de la composition de tableaux, de la composition littéraire...) que nous faisons, à partir d'observations quantitatives du monde. Oui, on peut prétendre que même pour les sciences de la nature, "la beauté est dans l'oeil qui regarde" : on ne découvre que ce que l'on décide de voir, telle la découverte des fullérènes dans cette suie qui est sous les yeux de l'humanité depuis la découverte du feu.
Mais quand même, n'y a-t-il pas des directions plus fructueuses que d'autres ?
Je ne sais pas, puisque, portant cette question conférence après conférence, dans le monde entier, je n'ai guère reçu de commentaires sur la question de la stratégie scientifique, qui est en réalité celle qui est discutée ici.
Mais revenons à la "direction de recherches". Je me demande quand même si ce que nous nommons "directeur de recherche", en France, n'est pas seulement la direction administrative de la recherche. C'est à dire un travail tout à fait sans intérêt du point de vue scientifique ! La vraie question n'est-elle pas la question de la recherche elle-même ?
Pour ce qui me concerne, quand j'agis en "directeur de thèse", par exemple, j'essaie surtout d'être un "rapporteur bienveillant", qui apporte de la culture scientifique, de cette culture qui permet de mieux voir les faits expérimentaux, de mieux les interpréter. Je suis là pour signaler des bonnes pratiques, les expliquer, et, surtout, pour être "contagieux d'enthousiasme" pour cette merveilleuse recherche scientifique.
Car nous avons besoin d'être entourés, aimés, encouragés, et non pas dirigés !
Bonnes pratiques : ne pas généraliser hâtivement
Vite, d'une frappe sur les doigts, faisons un élan vers le bonheur ! Dans ce Responsible Science, que j'ai déjà cité, je lis, comme répréhensible :
Using inappropriate statistical or other methods of measurement to enhance the significance of research findings;
En français "utiliser des méthodes statistiques ou des méthodes de mesures inappropriées pour donner à des découvertes de recherche plus d'importance qu'elles n'en ont". En réalité, la traduction du passage américain est difficile, parce que ce texte est lui-même un peu inexact : il dit "augmenter l'importance" ; or on ne peut pas augmenter l'importance d'une découverte, mais seulement faire croire que le résultat a plus d'importance qu'il n'en a en réalité. D'autre part, il y a une amphibologie au mot "significance", parce que, en statistiques, on parle de significativité, partant du bon principe que toute mesure est incertaine, et que, d'autre part, les théories sont toutes approximatives, même si leur précision va croissante.
Ce qui est clair, c'est que se pose ici la question du scientifique vis à vis de lui-même, et vis à vis de sa communauté. Si la juste ambition des scientifiques est de faire des découvertes, alors on comprend mal pourquoi on irait utiliser des méthodes fautives pour se tromper soi-même : au fond de soi, on sait bien quand on a observé un effet ou pas. A contrario, on sait qu'il y a hélas des individus qui vivent en représentation, et pour qui l'estime qu'on leur porte est plus importe que la justesse des idées qu'ils tendent à la communauté, en vue de s'en faire estimer. Et c'est à eux que s'adresse en réalité la phrase de l'Académie américaine des sciences.
Oublions-les, car ils ne méritent pas de cette considération qu'ils quêtent au prix de leur malhonnêteté. Et, vite, prenons positivement l'idée initiale : oui, ayant des résultats, pour nous assurer de leur justesse, nous avons souvent besoin de méthodes statistiques. Dans un autre billet, j'ai assez dit que nos mesures sont toujours imprécises à des degrés divers, de sorte que nos résultats expérimentaux ne concordent qu'imparfaitement à nos "théories", nos équations d'ajustement. C'est pour cette raison que nous avons besoin de savoir avec quelle probabilité il y a ou non concordance. Il nous faut des méthodes de mesure toujours plus précises, et il nous faut valider, afin de savoir ce qu'il en est de nos résultats.
Leur "importance" ? C'est là une autre question, bien difficile, et je propose de transposer cette phrase "la vertu est sa propre récompense" à nos études scientifiques : au lieu d'en chercher l'importance, utilisons bien notre temps à savoir si les résultats que nous produisons sont dignes d'être affichés, publiés. Validons, validons, et validons encore !
lundi 31 juillet 2017
Jour après jour, le sous blog "bonnes pratiques scientifiques" se constitue, sur le blog que je tiens dans le Centre international de gastronomie moléculaire AgroParisTech-Inra.
L'adresse du Centre ? C'est http://www.agroparistech.fr/Nouvelles-annonces.html
L'adresse du blog ? http://www.agroparistech.fr/-Le-blog-de-Herve-This-Vive-la-connaissance-.html
L'adresse du sous-blog ? http://www.agroparistech.fr/-Les-bonnes-pratiques-scientifiques-.html
Aujourd'hui, le billet concerne la recherche de théories, à partir des lois. Et c'est ici : http://www.agroparistech.fr/Abstraire-et-generaliser.html
L'adresse du Centre ? C'est http://www.agroparistech.fr/Nouvelles-annonces.html
L'adresse du blog ? http://www.agroparistech.fr/-Le-blog-de-Herve-This-Vive-la-connaissance-.html
L'adresse du sous-blog ? http://www.agroparistech.fr/-Les-bonnes-pratiques-scientifiques-.html
Aujourd'hui, le billet concerne la recherche de théories, à partir des lois. Et c'est ici : http://www.agroparistech.fr/Abstraire-et-generaliser.html
lundi 17 juillet 2017
Pourquoi un texte déjà publié dans une revue scientifique ne peut pas être soumis à une autre revue, dans une langue différente.
Partons d'un sain
principe : au vingt-et-unième siècle, les scientifiques sont
payés par les contribuables, et ils ont l'obligation de mettre à la
disposition de la communauté les résultats de leurs travaux. Ils
doivent donc publier des articles scientifiques. Mieux encore, on
comprend que leur travail sera d'autant plus efficace que leurs
publications seront plus lues : ils doivent donc privilégier
des revues où leurs publications ne passeront pas inaperçues. Et
cela quelle que soit la discipline : science de la nature, ou
science de l'humain et de la société, il faut que les publications
permettent l'avancée des sciences. Bref, c'est une bonne pratique
que de faire des choix de publications qui valorisent le plus
possible les travaux.
En quelle langue
publier ? La langue anglaise étant à ce jour la langue de la
communauté scientifique, il y a lieu de privilégier l'anglais.
Peut-on publier le même travail deux fois en anglais ?
Certainement pas, car cela impose une double charge sur la
communauté, à qui il revient d'organiser et de mettre en œuvre le
processus d'évaluation et d'édition : les auteurs qui n'ont pas été
éditeurs sous-estiment le temps d'édition, et tous ceux qui ont été
rapporteurs savent combien cela prend de temps de faire correctement
le travail. Il faut donc économiser les forces, les énergie,
l'argent de la communauté ;
Pourrait-on imaginer
de publier le même travail en français et en anglais dans deux
revues scientifiques différentes ? Pour ce qui serait du même
texte, cela n'est pas possible, car l'auteur cède à la revue qui
publie son article les droits de reproduction de ce texte ; une
fois le texte publié, il n'en est plus le propriétaire, de sorte
qu'il n'a plus la possibilité de céder les droits une seconde fois.
Et dans une revue « open », où l'auteur paye pour être
publié ? Cette fois, je me refuse à considérer ce cas, car je
déteste en réalité cette formule, dans laquelle se sont engouffrés
des sociétés d'édition assez malhonnêtes, qui deviennent juges et
parties : on comprends que, si l'auteur paye, la revue ait moins
de scrupules à lui refuser son texte. Et puis, le foisonnement des
publications fait peser une charge sur la communauté, dans la mesure
où les recherches bibliographiques sont alors compliquées. Il y a
une sorte d'irrespect des collègues à multiplier la publication
d'un texte.
Pour en revenir à
la question, d'une publication d'un même travail, en français et en
anglais, il y aurait un argument qui serait que la version anglaise
s'adresse à une communauté internationale et que la version
française touche mieux le public français. Toutefois, à cet
argument, il faut répondre que la communauté scientifique française
lit les textes en anglais, et que, quand même, ce choix fait peser
une double charge éditoriale sur les mêmes personnes, les
rapporteurs d'une bonne revue -qu'elle soit en français ou en
anglais- étant choisis internationalement.
Et puis, pourquoi
l'auteur d'un texte publié initialement en français, après
évaluation, édition, publication, ne se contenterait-il pas de
traduire le texte en anglais et de le mettre en ligre sur un site
personnel, avec une mention qui signalerait l'origine du texte
traduit ? Inversement il est parfaitement possible qu'un texte
publié en anglais soit traduit en français dans les mêmes
conditions… et toujours dans le respect des règles du droit
d'auteur, qui veulent, pour beaucoup de revues scientifiques à
l'ancienne, que l'auteur ne puisse en faire qu'un usage privé, à
savoir transmettre des tirés à part (aujourd'hui, des documents
pdf) à des collègues qui les demandent.
Reste le cas d'un
texte qui serait publié dans une langue minoritaire, et que l'auteur
voudrait publier dans une autre langue également minoritaire. Le bon
principe précédent (il faut publier aussi efficacement que
possible) montre qu'un auteur qui est dans ce cas fait deux fois un
choix malheureux : or perservare diabolicum ! Et
puis, cela impose à nouveau une double charge sur la communauté,
car je répète que les rapporteurs nationaux sont en réalités des
rapporteurs internationaux. Au nom de quel argument imposer une
double évaluation ? Je trouve que cela n'est pas respecter les
collègues, et j'invite tous mes collègues qui font un travail
d'édition scientifique à refuser de tels textes. Pour ce qui
concerne les auteurs, je propose que nous considérions commue une
bonne pratique ne pas se mettre dans cette position défavorable.
Enfin, il faut
signaler que la traduction automatique, qui nous vient de la
révolution numérique, change les choses : un texte en
n'importe quelle langue est aujourd'hui accessible. L'argument qui
consistait à dire que l'on ferait une diffusion plus efficace en
publiant en plusieurs langues ne tient plus.
mardi 4 juillet 2017
La sauvegarde des données
Une anecdote pour commencer : il y a plusieurs années, j'avais un ordinateur... dont je faisais mollement les sauvegardes. Il est arrivé, un jour, qu'il est tombé en panne, et que les données ont été perdues... sur quinze jours ! Vous vous rendez compte : deux semaines de travail perdues ! J'étais atterré... mais je sais aussi que l'expérience est intransmissible.
Puis, j'ai eu des disques durs de sauvagegardes, et j'ai fait des sauvegardes quotidiennes. Or il est arrivé -je le jure- que j'ai eu plusieurs fois des disques durs en panne, puis, pire, que j'ai eu un jour une panne à la fois d'un ordinateur et d'un disque dur. Pour cet événement, cela n'a pas été très grave... car, par hasard, j'avais une sauvegarde sur un second disque dur externe... et je n'ai perdu qu'une journée de travail. Mais quand même, pour quelqu'un qui travaille sans relâche, une journée de travail perdu, c'est rageant.
Pis encore : il est arrivé que j'ai eu un jour un ordinateur qui me lâchait, en même temps que deux disques durs externes ! Ce joura-là, je suis tombé des nues... mais j'avais trois sauvegardes, et je n'ai perdu qu'une heure, parce que la panne s'est produite en début de journée (j'avais sauvegardé la veille, au soir).
Depuis ce temps, j'ai personnellement plus de trois sauvegardes, en plus de mon disque dur, et je synchronise mes données à des moments différents pour les différents disques durs, pour des raisons qui sont exposées abondamment sur internet.
Mais passons à d'autres que moi.
1. Peut-on se contenter d'avoir des sauvegardes sur un dropbox ou sur le cloud ? Professionnellement, cela n'est admissible que si le serveur reconnaît la propriété des données à celui qui stocke, et non à celui qui héberge. Et, bien sûr, si l'on a plusieurs stockages différents, car on peut imaginer une panne du serveur, et la perte des données ainsi stockées.
2. Evidemment, on doit avoir des mise à jour soit en permanence, soit à des intervalles si courts que la perte serait sans trop de gravité (mais quand même, une heure perdue d'idées intéressantes, c'est déjà beaucoup.
3. On notera que l'on peut faire une différence entre sauvegarder et synchroniser, le second étant plus rapide, surtout quand on a un volume de données important, comme n'importe quel professionnel.
Bref, combien de sauvegardes avez vous ?
Puis, j'ai eu des disques durs de sauvagegardes, et j'ai fait des sauvegardes quotidiennes. Or il est arrivé -je le jure- que j'ai eu plusieurs fois des disques durs en panne, puis, pire, que j'ai eu un jour une panne à la fois d'un ordinateur et d'un disque dur. Pour cet événement, cela n'a pas été très grave... car, par hasard, j'avais une sauvegarde sur un second disque dur externe... et je n'ai perdu qu'une journée de travail. Mais quand même, pour quelqu'un qui travaille sans relâche, une journée de travail perdu, c'est rageant.
Pis encore : il est arrivé que j'ai eu un jour un ordinateur qui me lâchait, en même temps que deux disques durs externes ! Ce joura-là, je suis tombé des nues... mais j'avais trois sauvegardes, et je n'ai perdu qu'une heure, parce que la panne s'est produite en début de journée (j'avais sauvegardé la veille, au soir).
Depuis ce temps, j'ai personnellement plus de trois sauvegardes, en plus de mon disque dur, et je synchronise mes données à des moments différents pour les différents disques durs, pour des raisons qui sont exposées abondamment sur internet.
Mais passons à d'autres que moi.
1. Peut-on se contenter d'avoir des sauvegardes sur un dropbox ou sur le cloud ? Professionnellement, cela n'est admissible que si le serveur reconnaît la propriété des données à celui qui stocke, et non à celui qui héberge. Et, bien sûr, si l'on a plusieurs stockages différents, car on peut imaginer une panne du serveur, et la perte des données ainsi stockées.
2. Evidemment, on doit avoir des mise à jour soit en permanence, soit à des intervalles si courts que la perte serait sans trop de gravité (mais quand même, une heure perdue d'idées intéressantes, c'est déjà beaucoup.
3. On notera que l'on peut faire une différence entre sauvegarder et synchroniser, le second étant plus rapide, surtout quand on a un volume de données important, comme n'importe quel professionnel.
Bref, combien de sauvegardes avez vous ?
samedi 10 juin 2017
Bonnes pratiques en recherche scientifique
J'aurais dû le dire mieux : depuis quelques semaines, les billets de blogs sur sur le site d'AgroParisTech, où je me préoccupe de bonnes pratiques en recherche scientifique.
Aujourd'hu, c'est donc là http://www.agroparistech.fr/Tracabilite-et-qualite-de-nos-travaux-les-CAS.html que l'on trouvera une réflexion.
Surtout, la lire avec un peu de grandeur.
Aujourd'hu, c'est donc là http://www.agroparistech.fr/Tracabilite-et-qualite-de-nos-travaux-les-CAS.html que l'on trouvera une réflexion.
Surtout, la lire avec un peu de grandeur.
samedi 27 mai 2017
C'est ailleurs que j'étais actif ces jours-ci
On se souvient que je poste un billet par jour, mais il y a plusieurs sites différents.
Les jours derniers, j'ai été actif sur le site http://www.agroparistech.fr/-Les-bonnes-pratiques-scientifiques-.html, parce que je crois qu'il y a urgence à constituer un répertoire de "bonnes pratiques en science" : c'est ce que j'avais cherché il y a trente ans, que je n'ai pas trouvé, et que les revues scientifiques ne donnent pas ; d'ailleurs, elles ne sont pas habilitées à le donner, et c'est le rôle des académies, pas d'éditeurs privés, même quand les éditeurs sont des scientifiques qui travaillent (gratuitement) pour ces revues.
Bref, il y a lieu de continuer à aider nos jeunes amis et nous-mêmes en explicitant les règles de notre profession !
Si d'aventure vous avez l'idée d'un billet, je suis preneur à icmg@agroparistech.fr.
Les jours derniers, j'ai été actif sur le site http://www.agroparistech.fr/-Les-bonnes-pratiques-scientifiques-.html, parce que je crois qu'il y a urgence à constituer un répertoire de "bonnes pratiques en science" : c'est ce que j'avais cherché il y a trente ans, que je n'ai pas trouvé, et que les revues scientifiques ne donnent pas ; d'ailleurs, elles ne sont pas habilitées à le donner, et c'est le rôle des académies, pas d'éditeurs privés, même quand les éditeurs sont des scientifiques qui travaillent (gratuitement) pour ces revues.
Bref, il y a lieu de continuer à aider nos jeunes amis et nous-mêmes en explicitant les règles de notre profession !
Si d'aventure vous avez l'idée d'un billet, je suis preneur à icmg@agroparistech.fr.
vendredi 29 juillet 2016
Tu sais quelque chose ? Quelle est ta méthode ? Fais-le, et, en plus, fais-en la théorisation.
Le titre de ce billet est affiché sur les murs de notre laboratoire.
Pourquoi ? Pour répondre, il convient d’abord d’évoquer les documents
que nous nommons les « Comment faire ? », et qui sont une façon
d’améliorer la qualité de nos recherches. Il convient également
d’évoquer la méthode que nous mettons en œuvre pour notre travail
scientifique.
La suite sur http://www.agroparistech.fr/Tu-sais-quelque-chose-Quelle-est-ta-methode-Fais-le-et-en-plus-fais-en-la.html
Bonne lecture !
La suite sur http://www.agroparistech.fr/Tu-sais-quelque-chose-Quelle-est-ta-methode-Fais-le-et-en-plus-fais-en-la.html
Bonne lecture !
vendredi 27 novembre 2015
Pour les apprenants en sciences (bien qu'on apprenne sans cesse), par exemple en licence, on enseigne l'usage des droites de régression, et je vois qu'il y a lieu de s'interroger sur l'enseignement que nous donnons.
Posons le problème. Soit une série de données, par exemple des ordonnées en fonction d'abscisses ; nous cherchons à savoir si les couples de points (abscisse, ordonnée) sont alignés sur une droite.
La suite sur http://www.agroparistech.fr/Les-droites-de-regression-et-l-enseignement.html
Posons le problème. Soit une série de données, par exemple des ordonnées en fonction d'abscisses ; nous cherchons à savoir si les couples de points (abscisse, ordonnée) sont alignés sur une droite.
La suite sur http://www.agroparistech.fr/Les-droites-de-regression-et-l-enseignement.html
Pour les apprenants en sciences (bien qu'on apprenne sans cesse), par exemple en licence, on enseigne l'usage des droites de régression, et je vois qu'il y a lieu de s'interroger sur l'enseignement que nous donnons.
Posons le problème. Soit une série de données, par exemple des ordonnées en fonction d'abscisses ; nous cherchons à savoir si les couples de points (abscisse, ordonnée) sont alignés sur une droite.
La suite sur http://www.agroparistech.fr/Les-droites-de-regression-et-l-enseignement.html
Posons le problème. Soit une série de données, par exemple des ordonnées en fonction d'abscisses ; nous cherchons à savoir si les couples de points (abscisse, ordonnée) sont alignés sur une droite.
La suite sur http://www.agroparistech.fr/Les-droites-de-regression-et-l-enseignement.html
dimanche 18 octobre 2015
Luttons contre le Ragnarok
Le Ragnarok ? C’est ce moment terrible
dont les géants nous menacent… mais il faut d’abord expliquer mieux
toute cette affaire, avant d’expliquer le rapport avec le travail
scientifique.
Commençons avec les mythologies. Au fond, je ne suis pas certain d’aimer beaucoup les mythologies grecques, où les dieux vivent dans un palais doré sur l’Olympe, se chamaillant parce qu’ils sont oisifs. Je préfère de loin les mythologies alémaniques, dont il faut dire qu’elle sont nées en Alsace. Pour ces dernières, le récit mythologique est bien différent, à savoir que les dieux tels Wotan ou Freyja, etc. sont sans cesse menacées par les géants. C’est la raison pour laquelle ils vont chercher sur les champs de bataille des héros qu’ils ramènent au Valhalla, cette forteresse d’où les dieux et leurs soldats ne cessent de lutter contre les assauts des géants.
Ce que l’on doit redouter à tout instant, c’est que les géants ne submergent le monde des dieux et que ce soit la fin des temps : le Ragnarok. Pour cette mythologie, il n’y a donc pas d’état stationnaire merveilleux, béat, veule, idiot, mais plutôt un état de vigilance constante, de soins, d’attention, d’éveil...
A cette description, on comprend évidemment ma préférence pour cette seconde mythologie. Et si l’on sait d’autre part que j’ai inscrit dans mon laboratoire que nous devons nous méfier du diable, qui est caché derrière tous les détails, d’expérimentation et de calcul, on comprend aussi pourquoi j’évoque le Ragnarok. Il faut lutter sans cesse contre le Ragnarok. Ce n’est pas grave, mais c’est une nécessité. Il n’y a pas à se défendre, mais à repousser sans cesse les assauts des géants, à repousser ces derniers plus loin.
Luttons contre la pensée magique
Considérons maintenant la question de la pensée magique, cet état qui est dans tous les enfants, et que l’éducation doit contribuer à faire disparaître. La pensée magique commence avec l’enfant qui pleure et dont les cris font venir la mère. De là penser à ce que la pensée de la mère fait venir la mère, il n’y a qu’un pas, lequel est à la base de tous ces fantasmes de l’esprit sur la matière.
On aura beau penser que l’on peut tordre une cuiller par la pensée, on n’y parviendra pas. On aura beau penser à des préparations médicales qui guérissent tout, la panacée n’existera pas. Et ainsi de suite : je vous passe l’éventail complet de ces manifestations de la pensée magique ; il est infini, car fantasmatique.
L’enfant, donc, arrive dans nos communautés avec cette pensée magique qu’il faut déraciner, et c’est, je crois, un objet essentiel de l’éducation que de lutter contre elle. D’où l’importance de l’enseignement des sciences de la nature, qui montre les limites de la pensée, qui borde le réel.
Le rapport avec le Ragnarok ? C’est que la lutte n’est jamais terminée. Ce n’est pas parce que nous aurons oeuvré pendant quelques années contre la pensée magique que nous l’aurons éradiquée pour toujours : chaque nouvelle tranche d’âge revient avec la pensée magique, et c’est donc année après année que nous devons lutter.
Récemment, un ami d’un ministère déplorait que sa carrière n’avait pas eu le beaucoup d’effet sur la collectivité malgré des efforts importants, soutenus. Je l’ai rasséréné : en réalité, le monde aurait été bien plus mal qu’il n’est, s’il n’avait pas été aussi actif, et là encore, il y avait cette question du Ragnarok. Sans la diligence des fonctionnaires, la structure de nos collectivités irait à vau l’eau, et les efforts n’ont pas été vains : la preuve en est que le système fonctionne encore.
Et pour les sciences ?
Le mot « validation », que j’ai déjà évoqué, fait partie de la réponse. Pour produire des résultats de bonne qualité, il faut se préoccuper sans cesse de cette dernière ; il faut valider, il faut traquer les biais sans relâche, il ne faut jamais se satisfaire d’un résultat de mesures, il faut craindre l’erreur à chaque geste, à chaque calcul. L’erreur est tapie derrière chaque geste expérimental, chaque calcul. Même tourner un commutateur impose d’y penser puissamment, de crainte d’une erreur. Même l’emploi d’un simple thermomètre impose d’y avoir pensé, d’avoir imaginé que le thermomètre puisse être faux, ce qui nous aura conduit à des étalonnages… Et si le simple emploi d’un thermomètre impose ainsi un soin considérable, on imagine combien l’emploi de systèmes plus complexes doit s’accompagner de vérifications bien plus élaborées, bien plus poussées.
Pour le calcul, les jeunes étudiants qui font des mathématiques savent bien qu’une écriture brouillonne est source d’erreur : un g confondu avec un 9, et c’est la faute de calcul. C’est sans doute la raison pour laquelle le cahier de laboratoire du physicien Pierre Gilles de Gennes était si calligraphié : de la sorte, les possibilités d’erreur étaient réduites. Toutefois, avec cet exemple, on n’est qu’au tout début de la question, comme quand je considérais le thermomètre. Pour les calculs complexes, c’est comme pour les appareils d’analyse élaborés, à savoir que la complexité apporte avec elle bien plus de possibilités de se tromper, d’où les nécessaires validations, d’où le soin constant que nous devons apporter à nous assurer de nos travaux. On comprend alors qu’il n’est pas possible de publier vite des résultats scientifiques, car ceux-là ne s’obtiennent pas d’un claquement de doigt, et, au contraire, je crois que nous devons absolument considérer comme une faute la publication rapide de résultats.
Je propose, en conséquence, que les institutions scientifiques abandonnent cette insistance qu’ils ont que les chercheurs publient beaucoup. Bien sûr, il ne faut pas laisser des idées dans des tiroirs, mais je ne crois pas bon de publier des idées insuffisamment validées, et, sans être complètement paradoxal, je propose que les institutions scientifique en viennent même à pénaliser les publications trop nombreuses de certains, car il n’est pas possible qu’elles soient de bonne qualité… sauf exception bien évidemment, car il y a des individus plus actifs que d’autres.
On aura maintenant compris j’espère mon idée du Ragnarok. Pour toute activité humaine, et pour toute activité scientifique en particulier, nous ne devons pas craindre le Ragnanok, mais lutter pour qu’il ne survienne jamais. Et c’est ainsi que les sciences de la nature seront encore plus belles.
Finalement, les mythologies alémaniques, disons alsaciennes, sont une invitation à faire mieux, à devenir pleinement humains.
Commençons avec les mythologies. Au fond, je ne suis pas certain d’aimer beaucoup les mythologies grecques, où les dieux vivent dans un palais doré sur l’Olympe, se chamaillant parce qu’ils sont oisifs. Je préfère de loin les mythologies alémaniques, dont il faut dire qu’elle sont nées en Alsace. Pour ces dernières, le récit mythologique est bien différent, à savoir que les dieux tels Wotan ou Freyja, etc. sont sans cesse menacées par les géants. C’est la raison pour laquelle ils vont chercher sur les champs de bataille des héros qu’ils ramènent au Valhalla, cette forteresse d’où les dieux et leurs soldats ne cessent de lutter contre les assauts des géants.
Ce que l’on doit redouter à tout instant, c’est que les géants ne submergent le monde des dieux et que ce soit la fin des temps : le Ragnarok. Pour cette mythologie, il n’y a donc pas d’état stationnaire merveilleux, béat, veule, idiot, mais plutôt un état de vigilance constante, de soins, d’attention, d’éveil...
A cette description, on comprend évidemment ma préférence pour cette seconde mythologie. Et si l’on sait d’autre part que j’ai inscrit dans mon laboratoire que nous devons nous méfier du diable, qui est caché derrière tous les détails, d’expérimentation et de calcul, on comprend aussi pourquoi j’évoque le Ragnarok. Il faut lutter sans cesse contre le Ragnarok. Ce n’est pas grave, mais c’est une nécessité. Il n’y a pas à se défendre, mais à repousser sans cesse les assauts des géants, à repousser ces derniers plus loin.
Luttons contre la pensée magique
Considérons maintenant la question de la pensée magique, cet état qui est dans tous les enfants, et que l’éducation doit contribuer à faire disparaître. La pensée magique commence avec l’enfant qui pleure et dont les cris font venir la mère. De là penser à ce que la pensée de la mère fait venir la mère, il n’y a qu’un pas, lequel est à la base de tous ces fantasmes de l’esprit sur la matière.
On aura beau penser que l’on peut tordre une cuiller par la pensée, on n’y parviendra pas. On aura beau penser à des préparations médicales qui guérissent tout, la panacée n’existera pas. Et ainsi de suite : je vous passe l’éventail complet de ces manifestations de la pensée magique ; il est infini, car fantasmatique.
L’enfant, donc, arrive dans nos communautés avec cette pensée magique qu’il faut déraciner, et c’est, je crois, un objet essentiel de l’éducation que de lutter contre elle. D’où l’importance de l’enseignement des sciences de la nature, qui montre les limites de la pensée, qui borde le réel.
Le rapport avec le Ragnarok ? C’est que la lutte n’est jamais terminée. Ce n’est pas parce que nous aurons oeuvré pendant quelques années contre la pensée magique que nous l’aurons éradiquée pour toujours : chaque nouvelle tranche d’âge revient avec la pensée magique, et c’est donc année après année que nous devons lutter.
Récemment, un ami d’un ministère déplorait que sa carrière n’avait pas eu le beaucoup d’effet sur la collectivité malgré des efforts importants, soutenus. Je l’ai rasséréné : en réalité, le monde aurait été bien plus mal qu’il n’est, s’il n’avait pas été aussi actif, et là encore, il y avait cette question du Ragnarok. Sans la diligence des fonctionnaires, la structure de nos collectivités irait à vau l’eau, et les efforts n’ont pas été vains : la preuve en est que le système fonctionne encore.
Et pour les sciences ?
Le mot « validation », que j’ai déjà évoqué, fait partie de la réponse. Pour produire des résultats de bonne qualité, il faut se préoccuper sans cesse de cette dernière ; il faut valider, il faut traquer les biais sans relâche, il ne faut jamais se satisfaire d’un résultat de mesures, il faut craindre l’erreur à chaque geste, à chaque calcul. L’erreur est tapie derrière chaque geste expérimental, chaque calcul. Même tourner un commutateur impose d’y penser puissamment, de crainte d’une erreur. Même l’emploi d’un simple thermomètre impose d’y avoir pensé, d’avoir imaginé que le thermomètre puisse être faux, ce qui nous aura conduit à des étalonnages… Et si le simple emploi d’un thermomètre impose ainsi un soin considérable, on imagine combien l’emploi de systèmes plus complexes doit s’accompagner de vérifications bien plus élaborées, bien plus poussées.
Pour le calcul, les jeunes étudiants qui font des mathématiques savent bien qu’une écriture brouillonne est source d’erreur : un g confondu avec un 9, et c’est la faute de calcul. C’est sans doute la raison pour laquelle le cahier de laboratoire du physicien Pierre Gilles de Gennes était si calligraphié : de la sorte, les possibilités d’erreur étaient réduites. Toutefois, avec cet exemple, on n’est qu’au tout début de la question, comme quand je considérais le thermomètre. Pour les calculs complexes, c’est comme pour les appareils d’analyse élaborés, à savoir que la complexité apporte avec elle bien plus de possibilités de se tromper, d’où les nécessaires validations, d’où le soin constant que nous devons apporter à nous assurer de nos travaux. On comprend alors qu’il n’est pas possible de publier vite des résultats scientifiques, car ceux-là ne s’obtiennent pas d’un claquement de doigt, et, au contraire, je crois que nous devons absolument considérer comme une faute la publication rapide de résultats.
Je propose, en conséquence, que les institutions scientifiques abandonnent cette insistance qu’ils ont que les chercheurs publient beaucoup. Bien sûr, il ne faut pas laisser des idées dans des tiroirs, mais je ne crois pas bon de publier des idées insuffisamment validées, et, sans être complètement paradoxal, je propose que les institutions scientifique en viennent même à pénaliser les publications trop nombreuses de certains, car il n’est pas possible qu’elles soient de bonne qualité… sauf exception bien évidemment, car il y a des individus plus actifs que d’autres.
On aura maintenant compris j’espère mon idée du Ragnarok. Pour toute activité humaine, et pour toute activité scientifique en particulier, nous ne devons pas craindre le Ragnanok, mais lutter pour qu’il ne survienne jamais. Et c’est ainsi que les sciences de la nature seront encore plus belles.
Finalement, les mythologies alémaniques, disons alsaciennes, sont une invitation à faire mieux, à devenir pleinement humains.
Inscription à :
Articles (Atom)
